Indret : Une fonderie de canons ( 1777 - 1828 )


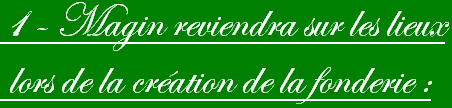
Lorsqu'à la mi-mai 1777, alors que la
décision est prise de créer une fonderie à Indret, De Sartines, ministre de la
Marine fera appel à Magin pour les travaux hydrauliques qui doivent y être effectués.
Il sait que ce dernier a fait des travaux sur le site il y a une vingtaine d'années
(Voir la page La Loire avant 1777 et s'adresse au commissaire
de la marine à Nantes : « vous
observez que vous n'avez personne qui ait assez de connoissance de la partie
hydraulique pour conduire les ouvrages qui doivent être faits dans l'eau. La
même observation ayant été faite par Mr de Serval je mande à cet officier
que je donne ordre au sieur Magin qui a déjà fait avec succès plusieurs
ouvrages dans la rivière de Loire de se rendre à Nantes pour diriger ceux
qu'il y aura à faire pour l'établissement dont il s'agit. J'enjoins à cet
ingénieur de se concerter avec Mr de Serval et vous, ainsi qu'avec le sieur
Wilkinson, sur les mesures qu'il y aura à prendre pour l'exécution des
ouvrages dont il sera chargé. Je ne doute pas que vous concouriez en ce qui
vous concerne au succès de ces opérations ».
Les espoirs de ce ministre seront vite déçus. En effet, les travaux dont
Magin aura la responsabilité consistent en la création d'un bassin
d'alimentation pour la forerie hydraulique qui doit être implantée.
Wilkinson, chargé de la création de la fonderie, tient essentiellement à ce
que la forerie soit à proximité immédiate de la fonderie. Les digues
existantes sont pour lui un atout intéressant puisqu'il peut s'en servir,
moyennant quelques modifications, pour le but recherché.
Oui, mais ... Magin sait pertinemment bien que ces digues ont été conçues
pour permettre l'envasement de la zone convoitée et qu'elles ne peuvent
convenir. Il cherchera d'autres sites plus appropriés et commencera même des
travaux d'enrochement à Basse-Indre dans cette optique. Sans doute soucieux
de ne pas brusquer Wilkinson il avait retenu cet emplacement car :
« on s'est déterminé pour ce moulin à l'établir à l'entrée
d'un étier à la côte de la Basse-Indre en face du château de l'isle d'Indret
et assez près pour s'entendre des fourneaux au moulin par le moyen d'un porte-
voix ; la nature paroît y réunir tous les avantages et la dépense infiniment
moindre qu'elle n'auroit été sur Indret ». C'était sans compter
avec l'opiniâtreté de Wilkinson qui tient par-dessus tout à avoir la forerie
au plus près.
Les deux hommes ont un caractère bien trempé et l'entente ne peut avoir lieu.
A la mi-juillet , Magin reçoit le soutien de De Sartines : « j'approuve
que le moulin à forer soit établi à la Basse-Indre puisqu'il doit en résulter
plusieurs avantages ». Le 8 août, nouvel appui : « J'ai vu qu'après
avoir été examiné avec les mêmes personnes et le sieur Wilkinson les
différents endroits de la Basse-Indre, vous avez fait choix de celui qui
sera le plus convenable pour l'établissement du moulin à forer ».
Ce serait mal connaître Wilkinson, 16 jours plus tard le Ministre écrit : «
Le sieur Magin m'a informé, Monsieur, qu'ayant commencé à faire escarper les
rochers sur lesquels le moulin à forer doit être construit, le sieur
Wilkinson lui a dit qu'il ne doit pas se mêler de cette partie. Je lui
marque en réponse que j'approuve que pour maintenir la bonne intelligence il
ait déclaré qu'il ne s'en occupera plus mais je vous demande de me faire
sçavoir quelle raison le sieur Wilkinson peut avoir eue pour arrêter le
travail du sieur Magin qui a des connoissances très étendues sur les
ouvrages de l'espèce dont il s'agit ». Ce courrier marque
l'incompréhension du ministre devant les raisons d'un tel acharnement. Au
travers des documents qui retracent les travaux de Magin durant la fin des
années 1750, il semblerait que ce dernier ait eu une fâcheuse tendance à
vouloir garder par devers lui un certain nombre d'éléments propres à lui
assurer une connaissance non partageable des dossiers. Alors Magin s'est-il
gardé de trop expliquer les motivations de ces refus d'implanter la forerie
sur la côte sud de l'île d'Indret ? La chose paraît probable mais ne peut
être affirmée à l'heure actuelle. Il se contentera d'indiquer que la surface
nécessaire pour mouvoir la forerie « rend le projet impraticable ».
Le 13 septembre, retournement complet de situation, De Sartines rappelle
Magin et va nommer Toufaire, ingénieur des bâtiments civils à Rochefort pour le
remplacer. Nulle part dans ces courriers on ne trouve trace de la motivation
qui avait prévalu à la construction de ces digues. Toufaire allait donc
commencer un chantier en n'ayant pas tous les éléments.

Ces digues étaient conçues,
nous l'avons dit, pour boucher
la partie sud du fleuve. La digue amont " de Rocheballue " était constituée
de pierres posées entre l'île Mandine et celle du Petit Masssereau. Elle
était donc submersible lors de chaque marée. La digue de Boiseau
(aujourd'hui de La Montagne) plus résistante était d'un niveau supérieur.
Une troisième reliait l'île du Petit Massereau à celle d'Indret. Le principe
était simple : lors de chaque marée montante, les eaux passaient par dessus
la digue amont et étaient retenues par la digue aval. Lors de la marée
descendante, elles demeuraient prisonnières entre ces constructions et les
vases et sables en suspension se déposaient dans ce vaste espace.
L'efficacité du système était performante. Plusieurs plans nous montrent
qu'en peu d'années 3 îles s'étaient formées entre ces deux digues dont 2
comportant une prairie. En outre de nombreux dépôts de vase et de sable
étaient également apparues dans cette zone obstruant ainsi un fort
pourcentage de la superficie concernée.
Perronet « premier ingénieur de Sa Majesté, chevalier de l'ordre du Roy»
avait été chargé le 6 septembre 1769 de procéder à une visite des ouvrages
effectués en Loire suite à une contestation sur leur qualité. S'il notera
qu'effectivement les travaux n'ont eu qu'une incidence mineure en plusieurs
points, par contre dans la zone Indret-Couëron, leur efficacité est bien
réelle.
Ce même Perronet reviendra 9 ans plus tard sur les lieux et le 23 juin 1778
alors que la fonderie de canons avait commencé son implantation dans le
paysage local, il rédigera un nouveau rapport qui nous en révèlera
davantage sur les digues d'Indret.
La première chose qu'il nous apprend, c'est que la digue de Boiseau (La
Montagne) reste toujours, à cette époque, celle réalisée par Magin : « La
nouvelle digue au droit de la machine à forer de 140 toises de long sera
appuyée à ses extrémités contre le rocher et élevée de 5 pieds 6 pouces au-
dessus des plus basses eaux et de 2 pieds 3 pouces à 2 pieds 6 pouces au-
dessus de l'ancienne digue actuelle ».
Il nous confirme par la même occasion que cette ancienne digue sera modifiée
pour répondre au nouveau besoin : « La largeur de la digue du premier au
dernier file de pieux aura 50 pieds, elle sera composée au total de 6 files
de pieux en se servant des deux de l'ancienne digue ».
Quant à l'ancienne chaussée de pierres qui relie Indret à Roche-Ballue, elle
n'aura plus lieu d'exister, du moins dans sa forme actuelle, puisque : «
Le réservoir supérieur a 90 000 toises de surface au moyen de la digue
supérieure de 200 toises de longueur en deux parties que l'on a commencé de
construire ».
Cette retenue d'eau aura 4 pieds de hauteur lors des plus grandes
sécheresses et bas marécages note-t-il également, l'histoire montrera très
rapidement que cette assertion sera très vite obsolète. 2 400 pieux
s'avèreront nécessaires pour la réalisation du site, 1 500 seront enfoncés
de 12 à 15 pieds dans le sable (4 à 5 mètres), certains toucheront le rocher
enfoui ce qui fera dire à cet ingénieur qu'il y a lieu de croire que celui-
ci doit s'étendre sur route la largeur de la rivière.
Malgré qu'« Il peut y avoir actuellement environ 300 ouvriers journaliers
de toute espèce d'employés à cette entreprise compris ceux des carrière
[... ...] on estime que les digues ne pourront pas être achevées avant la
fin de la campagne prochaine, c'est-à-dire à la fin de 1779 » mentionne
Perronet.
Mais ces digues seront également percées par des écluses qui permettront
l'entrée des eaux dans le bassin. Celles-ci se trouvent être au nombre de 6 :
- 3 d'entre elles se trouvent sur la digue inférieure (celle de Boiseau)
- 2 sur la digue supérieure (Roche-ballue)
- 1 entre les îles du petit Massereau et celle d'Indret.
Les trois écluses amont comportent chacune un passage d'eau large de 48
pieds (près de 16 mètres) et sont équipées de 7 vannes pour permettre un
flux important alors que les vannes aval ne comportent que deux passages de
22 pieds (7,33 mètres) pour les édifices le plus au sud et un de 16 pieds à
côté de la forerie. Elles ne comportent que 3 ou 4 vannes.
Notons également qu'entre l'écluse située près de la forerie et celle-ci se
trouve un pont-levis de 29 pieds le long (près de 10 mètres). Précaution
sans doute consécutive à un propos du ministre De Sartines qui avait dit : «
enfin, l'isolement de celle-ci [l'île d'Indret] serait favorable à la mise
au point, à l'abri d'indiscrétions, d'une fabrication précieuse pour la
défense du royaume », Rappelons qu'à cette époque, la digue débouchait
sur les rochers en bas de Boiseau (La Montagne) et qu'aucun chemin n'y
débouchait. L'isolement d'Indret était donc bien réel.

Il est un fait incontestable : Magin fut nommé spécialement pour trouver une
solution aux problèmes d'envasement du fleuve. Sa technique consista à créer
des obstacles dans le lit du fleuve pour qu'une partie du lit soit comblée.
Perronet, on l'a vu, mentionna bien que dans la zone Indret-Couëron les
résultats furent probants.
Lors de l'implantation de la nouvelle forerie, Magin connaissait donc les
conséquences prévisibles d'une implantation en ces lieux de la retenue d'eau
nécessaire pour alimenter en énergie hydraulique le forage des canons qui, à
cette époque devait être le seul moyen de forer sur l'île. Les retards pris
lors de cette construction firent qu'une forerie provisoire à chevaux dut
prendre le relais pour les canons de petit calibre alors même que cette
solution avait été totalement écartée quelques mois plus tôt par manque de
régularité. Lorsque l'ensemble des travaux fut terminé, très vite on
s'aperçut des limites de cette installation. Agustin de Bétancourt, ingénieur
espagnol, qui vint en ces lieux condamna sans appel cette forerie au profit
d'une nouvelle machine à vapeur qui s'était implantée en 1784 sur l'île
encore que, convient-il de le préciser, cette machine n'était pas à la
pointe du progrès puisqu'il s'agissait d'une machine à simple effet alors
que Watt avait déjà mis au point celle à double effet. Les plans détenus par
les Archives municipales de Nantes montrent également que d'importantes
zones se trouvaient déjà obstruées entre les digues et ce, dès 1785, soit
moins de 7 ans après la fin de l'aménagement des lieux.
En 1781, soit moins de 3 ans après la mise en service de la forerie
hydraulique, suite à une importante sécheresse, la hauteur d'eau dans le
bassin ne permettait plus le forage alors que dans le pire des cas, il était
prévu une hauteur minimale de 4 pieds.
Les deux digues qui enserraient ce bassin avaient également créé des
atterrissements en amont et en aval qui appartenaient à de petits seigneurs
locaux tels que le Marquis de Martel et le comte d'Aux du Bournay, tous deux de St Jean
de Boiseau. Ces terres gagnées sur le fleuve étaient donc un obstacle et
c'est ainsi que le commissaire de la Marine à Nantes mentionnera au Ministre
: « l'intérêt qu'il y auroit à la consommation pour cet établissement de
détruire les dits atterrissements qui de plus en plus deviennent nuisibles à
la forerie ». Les craintes de procès qui apparaissaient alors ont-elles
été un frein ?
Durant toutes les années de fonctionnement de cette fonderie, nombreuses
furent les tentatives de curage de ce bassin de rétention. Aucune d'elles ne
fut pérenne malgré le nombre de personnes parfois employées à cette tâche.
Il ne faut pas non plus sous-estimer le côté ingrat de ces travaux : «
Comme il est indispensable de profiter de la belle saison, je ne saurais
trop insister pour obtenir de Votre Excellence une très prompte autorisation
pour les commencer. Les mois de 7bre et d'octobre sont les plus propres et
même les seuls convenables pour le curage du bassin ; d'abord par les basses
eaux et ensuite parce que l'on ne pourrait sans inhumanité faire mettre plus
tard des ouvriers dans l'eau et dans la boue ». Toutes ces vaines
tentatives provoquèrent à la longue un sentiment d'impuissance. Ainsi, en
1824, le ministre écrit-il : « Les travaux de curage et de déblais
proposés pour améliorer le bassin du moulin à forer ne doivent être
entrepris qu'autant qu'il sera préalablement constaté qu'ils produisent un
bon résultat ».
En 1828, lorsque Gengembre vint à Indret étudier les lieux pour implanter la
future manufacture de machines à vapeur, il écrivit : « Par l'effet du
temps et aussi par défaut de soins, les vases se sont accumulées dans ce
bassin à un tel point que les eaux suffisent à peine pour faire marcher les
roues pendant 4 heures par jour, terme moyen. Une force aussi irrégulière,
exposée à des chômages journaliers, variables et aussi incommodes, ne peut
en aucune manière, convenir à une usine de l'espèce de celle qu'il s'agit de
former à Indret ; il est en outre à considérer que la forerie hydraulique
étant en dehors et à une assez grande distance de l'enceinte fermée de la
manufacture, on ne pourrait en faire usage sans de graves inconvénients, il
est bien préférable d'y renoncer. La retenue devenant dès lors inutile il y
aura lieu d'examiner plus tard quel sera le meilleur parti à prendre, soit
de laisser combler le canal qui existe le long de la prairie, soit d'enlever
toutes les retenues afin de fournir au bras gauche de la Loire un libre
passage, changement qui sous le rapport de la salubrité aurait probablement
de grands avantages ».
Ainsi en 1785 et en 1828, on parle de supprimer les digues créées par Magin.
Aujourd'hui, elles sont toujours là et ont marqué d'une manière indélébile
le paysage. Qui, les arpentant actuellement lors d'une promenade, pourrait
se douter des motivations qui prévalurent à leur construction et de leur
usage à contre-sens 20 ans plus tard ?
Si, durant les 5 décennies où cette fonderie fit les beaux jours de
l'artillerie de marine, de nombreux textes sont relatifs à l'envasement du
bassin de la forerie, aucun ne mentionne les raisons qui incitèrent Magin à
réaliser ces digues artificielles. Magin fut-il trop discret ? Il paraît
paradoxal que cette information, si capitale, se soit effacée dans les
souvenirs des dirigeants de l'époque.