Indret : Une fonderie de canons ( 1777 - 1828 )


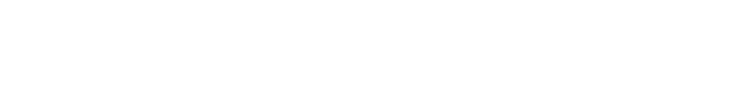
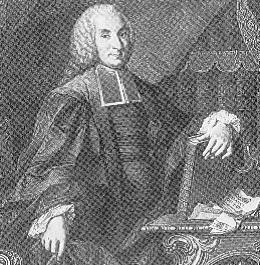
Homme politique. (Barcelone 12/071729 - Tarragone 07/09/1801), Conseiller (1752),
puis lieutenant criminel (1755) au Châtelet de Paris, il est lieutenant général
de police de Décembre 1759 à Mai 1774.
S'attachant à améliorer les services de la capitale, notamment ceux de
l'approvisionnement (il active la construction de la halle aux blés), de
l'éclairage (il fait établir des lanternes à réverbère), ainsi que la sécurité
publique, Sartine fait de Paris le modèle des capitales européennes. Il
substitue également aux tripots clandestins des maisons de jeux surveillées par
ses agents et taxées au profit du fisc. Il abusa de l'espionnage et du "cabinet
noir" pour amuser la vieillesse corrompue de Louis XV. Appelé au secrétariat
de la Marine le 24/08/1774, il hâta l'accroissement de la flotte en vue de la
guerre contre l'Angleterre et dépassa de 20 millins la somme dont le conseil du
roi était convenu. Conseillé par le directeur des Ports et Arsenaux, Fleurieu,
Sartine entreprend là aussi de grandes réformes, mises au point par sept
ordonnances (1776). La haute main sur la Marine est donnée aux officiers au
détriment des administrateurs civils. Les constructions navales sont activement
poussées. Enfin la qualité du corps des officiers, recruté surtout dans la
noblesse, est elle-même considérablement améliorée. Cette politique portera ses
fruits pendant la guerre d'indépendance américaine. Mais Sartine ne sait pas
arrêter le gaspillage de ses officiers. Necker qu'il déclarait vendu aux
anglais obtient son renvoi le 14/10/1780. Le roi lui accorde néanmoins une
gratification de 150 000 livres et une pension de 70 000 livres. Détesté des
écrivains et du public comme ayant détenu longtemps l'arme arbitraire des
lettres de cachet, stigmatisé par Manuel dans "la Police dévoilée", il émigre
dès 1790, évitant ainsi le sort de son fils, Charles-Marie-Antoine et de sa
bru, guillotinés le 17 juin 1794.

Maréchal de France (Paris 1727, Wolfenbüttel 1800). Fils d'un maréchal de camp, entré dans le métier des armes à 16 ans, il est nommé lieutenant-colonel d'un régiment dès 1744, puis brigadier, commissaire général de la cavalerie et maréchal de camp en 1748. Lieutenant Général en 1759, il vainc le duc de Brunswick l'année suivante à Clostercamp. Après la paix, il reçoit successivement les gouvernements de Flandre et de Hainault, le ministère de la Marine (1780) et le bâton de Maréchal de France (1783). Les sept années de son passage à la Marine sont marquées par une réorganisation profonde de notre flotte de guerre. La Révolution le contraint à émigrer. C'est son ancien adversaire de Clostercamp, devenu son ami, Brunswick, qui le recueille.
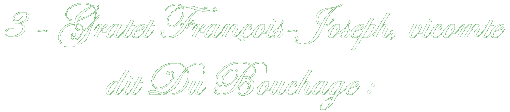
Homme d'Etat français, né à Grenoble la 01/04/1749, mort à Paris le 12/04/1821. Entré au service en 1763, il devint en 1784 chef de brigade dans l'artillerie des colonies et, deux ans plus tard, sous-directeur de l'artillerie de marine à Brest. Nommé maréchal de camp en 1792, il fut cette même année appelé au ministère de la marine qu'il accepta (21 juillet) après plusieurs refus. Royaliste dévoué, il donna dans la nuit du 9 au 10 août des conseils énergiques à Louis XVI qui ne sut pas les suivre. Réduit peu après à fuir, il ne revint en France que sous le Directoire. Plus tard, il résista aux avances de Bonaparte, fut arrêté en 1805 comme agent des Bourbons et mis en surveillance à Paris. Il salua avec joie en 1814 le retour de Louis XVIII qu'il servit secrètement pendant les Cent-Jours et qui, après la seconde Restauration, le rappela au ministère de la marine (27 septembre). Dans ce haut emploi, Du Bouchage fit surtout preuve de son zèle légitimiste. C'est lui qui, pour faire honneur au Duc d'Angoulême, eut l'idée singulière de créer une école de marine dans la ville dont ce prince portait le nom. Nombre de bons et vieux officiers furent par lui exclus de la flotte et remplacés par des incapables qui, comme celui qu'il mit à la tête de la frégate « La Méduse », n'avaient d'autre mérite que leur royalisme. Du Bouchage désapprouva l'ordonnance du 5 Septembre 1816 et la politique modérée dont elle était l'indice. Aussi ne resta-t-il pas longtemps au ministère. Il en sortit le 22 Juin 1817, fut nommé Ministre d'Etat et entra à la Chambre des Pairs où, jusqu'à sa mort, il vota d'ordinaire avec le parti ultra-royaliste.
Vice-amiral français né à Châteauvillain (Haute-Marne) le 22 Juin 1761, mort le 7 Décembre 1820. Il entra dans la marine à l'âge de 14 ans comme aspirant, et parcourut successivement les différents grades, combattant aux Indes et dans les Antilles. Promu Capitaine de Vaisseau en 1793 à l'âge de trente et un ans, on le destitua peu après, par mesure de sûreté générale. On ne lui rendit son grade qu'en 1795. Trois ans plus tard on le nommait contre-amiral. Placé à l'arrière-garde à Aboukir, il essuya pendant près de trois heures le feu des anglais. Puis, cerné dans Malte par l'escadre anglaise, il força le blocus avec le vaisseau « Guillaume Tell » ; mais poursuivi par les vaisseaux ennemis, il succomba sous le nombre, et ne se rendit qu'après avoir perdu les trois mâts de son vaisseau. L'amiral DECRES, nommé Ministre de la Marine en 1801, conserva ce poste pendant treize ans, laissant un matériel composé de 103 vaisseaux et 54 frégates, alors qu'il n'avait trouvé à son arrivée que 5 vaisseaux et 41 frégates.
Magistrat, Publisciste et homme politique français né à Paris le 4 juillet 1751, mort à Paris le 17 Janvier 1825. Il occupa quelque temps par intérim le ministère de la marine vers 1814-1815. Fort opposé aux principes de Révolution, il émigra dès Septembre 89, fit partie du conseil du Prince de Condé, puis du conseil de Régence institué par Monsieur après la mort de Louis XVI.
Magistrat et homme d'Etat français né en 1761 à Bar-sur-Aube, mort à Bayeux le 24 juin 1835. Au moment de la Révolution, il était lieutenant-général du présidial de sa ville natale. En 1790, il fut nommé procureur-général syndic du département de l'Aube, et, en 1791, membre de l'Assemblée Législative, où il siégea dans les rangs du parti constitutionnel. C'est lui, qui sous la Terreur, dénonça Marat comme ayant provoqué l'assassinat du général Dillon, et fit rendre contre lui le décret d'accusation. Ce fut son tour, un peu plus tard d'être dénoncé, puis incarcéré à la Force, où il resta jusqu'au 9 Thermidor. Il resta éloigné de la vie publique jusqu'après le 18 Brumaire, il fut alors attaché, en qualité de conseiller intime à Lucien Bonaparte, qui était ministre de l'Intérieur. Il devint ensuite successivement préfet de la Seine- Inférieure, conseiller d'Etat et ministre des Finances de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. En 1808, Beugnot, depuis peu administrateur du grand-duché de Berg et de Clèves, reçoit la croix d'officier de la Légion d'honneur, avec le titre de comte. Revenu en France, en 1813, après la défaire de Leipzig, il fut nommé préfet du Nord. Après la déchéance de Napoléon, en 1814, il reçut du gouvernement provisoire le portefeuille de l'Intérieur et de Louis XVIII la direction générale de la police, puis le ministère de la marine. Pendant les Cent Jours, Beugnot suivit Louis XVIII à Gand. Sous la seconde restauration, il fut quelque temps Directeur Général des postes ; mais le parti dominant lui fit retirer cet emploi et ne lui laissa, comme retraite, que le titre de Ministre d'Etat sans fonctions. Beugnot resta alors à la Chambre Législative, d'abord comme député de la Haute- Marne, puis comme député de la Seine-Inférieure. Il y siégea à gauche et s'y signala en 1819 par l'énergie avec laquelle il soutint le principe de la liberté de la presse. En 1824, il donna sa démission de député. Le gouvernement de Juillet le nomma Pair de France et, en même temps, Directeur Général des Manufactures et du Commerce. M. Beugnot a laissé de curieux Mémoires qui ont été publiés par son petit- fils (1866. 2 vol. in-8).
Né à Paris le 24 Janvier 1781, mort à Champlâtreux (S. et O.) le 23 Novembre 1855. Ecarté des affaires sous la 1ère Restauration, il reprit sa place au Conseil d'Etat et sa direction générale pendant les Cent-Jours et fut même nommé Pair de France (2 Juin 1815) mais louvoya si bien entre les partis que Louis XVIII rétabli après Waterloo lui confirma ses emplois et lui conféra à son tour la Prairie (17 Août). Fut appelé par Richelieu (12 Septembre 1817) au ministère de la Marine, se retira avec lui le 28 Décembre 1818.

Né à Abarèdes près de Montauban le 31 Octobre 1765, mort à Bordeaux le 11 Janvier 1845. Il déclina les fonctions de maître des requêtes que lui avait données l'Empereur, les accepta de Louis XVIII, refusa la mairie de Bordeaux aux Cent-Jours, fut nommé par le roi Directeur des colonies (1815) ; élu député du Tarn et Garonne, il siégea au centre droit et occupa du 29 Décembre 1818 au 13 Décembre 1821 le poste de Ministre de la Marine et des Colonies ; il fit augmenter son budget de 45 à 65 millions, s'appliqua à fusionner l'ancienne et la nouvelle marine. A sa démission, le roi le nomma Ministre d'Etat et Pair de France.
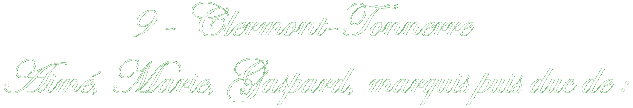
Général et Ministre français né à Paris le 27 Novembre 1779, mort au château de Grisolles le 8 Janvier 1865. Il servit quelque temps dans l'artillerie, fut attaché en 1808 au roi Joseph frère de Napoléon en qualité d'aide de camp. La Restauration le combla d'honneurs. Pendant les Cent-Jours, il suivit Louis XVIII à Gand. Le parti de la congrégation qui s'empara du pouvoir à la fin de 1821 crut devoir lui donner un portefeuille. Il fut d'abord Ministre de la Marine et passa en 1823 au département de la guerre. Il tomba avec le ministère Villèle (Déc. 1827).

Né à Riom le 16 Novembre 1771, mort à Chabannes le 7 Août 1836. Il entra dans l'administration à la fin du Consulat, fut auditeur près le Ministre de la Justice en 1803, premier président de la cour d'appel d'Orléans de 1804 à 1807, maître des requêtes en 1808, président de la cour d'appel de Paris en 1810, Conseiller d'Etat en 1814, puis préfet du Rhône ; Disparut pendant les Cent-Jours mais reprit son poste à Lyon dès le commencement de la deuxième Restauration. Son attitude fut telle quand la réaction royaliste ensanglanta cette ville qu'on dut le mettre en disponibilité. Il devint ensuite sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l'Extérieur 1817, député en 1821, Pair de France en 1823, Ministre de la Marine le 4 Août 1824 et Ministre des Finances dans le cabinet Polignac, puis continua à siéger à la chambre des Pairs. Après la Révolution de 1830, il rentra complètement dans la vie privée.

Né à la Charité sur Loire le 24 Janvier 1776 mort à Paris le 26 Mai 1857. Dès 1793, il fut des agents les plus actifs de l'émigration en France, prit part à l'insurrection royaliste de Berry en 1796. Après le 18 Brumaire, il essaya de déterminer (sans succès) Bonaparte à ramener les Bourbons. Il combattit le ministère Villèle et obtint en 1827 un double mandat et entra dans le cabinet Martignac comme ministre de la Marine (3 Mars 1828).